Partager sur
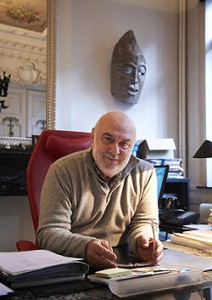 Il a été souvent écrit que la loi sur les marchés public se confondait avec l’ histoire de Belgique.
Il a été souvent écrit que la loi sur les marchés public se confondait avec l’ histoire de Belgique.
Il faut bien admettre que très tôt les gouvernants se sont souciés de la possibilité pour les services publics de souscrire des conventions avec le secteur privé en écartant toute espèce de discussion sur la régularité de l’attribution, que ce soit du népotisme ou toutes autres raisons..
Il est certain que notamment le principe d’égalité qui préside au fonctionnement des services publics avait comme conséquence que les différents marchés puissent être ouverts et que l’attribution en soit décidée sur base de critères objectifs.
Cette réflexion justifie donc la naissance et le développement d’une législation spécifique.
Le problème est que s’il ne peut y avoir de contestation utile quant à une grande quantité de marchés (et principalement les marchés de travaux et de fournitures) le champ d’application a été élargi au marché de services. Or, dans le cadre de prestations de services et plus particulièrement s’agissant d’avocat ou de médecin, et peut-être dans une moindre mesure de toutes professions libérales, il y a lieu de prendre en considération des éléments que la loi ignore comme par exemple la confiance.
Il est clair que lorsqu’un client consulte un avocat, il en attend certes compétence et sérieux mais nous savons tous très bien que s’il ne nait pas un rapport de confiance et au-delà de celui-ci, une compréhension, il sera très difficile d’apporter à ce client la relation qu’il est en droit d’attendre et les actes posés en son intérêt seront toujours nimbés de doutes dans son esprit.
Je pense pouvoir écrire que cette relation particulière est tout aussi sensible entre le médecin et son patient, ou le comptable et son client.
Il s’agit là d’une des nombreuses justifications de la déontologie et de son aspect lié au secret professionnel.
Les marchés de services et les critères objectifs de choix ne permettent en rien d’introduire cette notion cependant indispensable.
Par ailleurs, les critères utilisés au niveau des cahiers des charges permettent, par leur caractère purement matériel, d’« orienter » les marchés pour déterminer à l’avance si ce n’est déjà le choix du candidat qui sera retenu mais à tout le moins la petite fourchette de ceux dont l’offre sera dite recevable.
Un bon exemple vient d’être donné par un appel d’offre émanant du Ministère de la Défense Nationale s’agissant de recruter un avocat relevant de la Cour d’Appel de Mons, Bruxelles francophone ou Liège pour la représentation en Justice de l’Etat Belge, section Défense.
Le marché contient une phase de sélection.
Dans ceux-ci, on trouve divers critères relatifs au personnel disponible, à la capacité organisationnelle, à l’expérience et à la qualité des services, à l’expertise et à la disponibilité.
Tout cela parait assez naturel mais il faut se rendre compte que par personnel disponible, on entend les collaborateurs intellectuels c'est-à-dire les avocats ou les juristes, la cote maximale étant attribuée lorsque l’on a 15 collaborateurs au moins, un zéro pointé étant attribué lorsqu’on a moins de 6 collaborateurs.
A cela s’ajoute les correspondants à l’étranger où la cote maximale est attribuée si on a 20 correspondants ou plus.
La capacité organisationnelle s’apprécie sur le fait que le cabinet visé aurait effectivement traité idéalement 400 dossiers ou plus, les dossiers traités étant ceux qui ont été terminés et ce par an.
A moins de 100 dossiers, c’est aussi un zéro pointé.
Dans le cadre de l’expérience et des prestations, les cotes les plus favorables sont attribuées au cabinet qui aura traité plus de 9 matières différentes et plus de 100 dossiers par an devant une juridiction supérieure.
Il faut aussi justifier d’expérience des pouvoirs publics dits pertinents définis comme les services publics fédéraux, communautaires et régionaux.
Je crois qu’il ne faut pas en écrire plus pour que chacun se rende compte qu’en réalité seuls quelques cabinets peuvent valablement postuler à ce titre …
Un autre exemple a été donné en matière de marché public visant les contentieux ; Il suffit en effet lorsqu’un veut écarter la candidature d’un candidat de prévoir dans les critères d’appréciation un certain nombre de prestations qui sont déontologiquement impossibles comme par exemple le démarchage chez le débiteur ou l’application du principe « no cure, no pay ».
Il ne faut pas chercher ailleurs le succès des sociétés de recouvrement avec le cortège de plaintes dont nous avons tous été les confidents.
Faut-il écrire que la justification de semblables conditions est assez facile à rédiger ainsi qu’à motiver (puis-je répéter les mots d’un responsable de contentieux me disant : « déjà que l’on me doit de l’argent, je ne vais pas payer en plus pour le recouvrer » .
C’est certes suave mais ce n’augure de rien de bon, pour personne d’ailleurs.
N’est-il pas aujourd’hui assez « merveilleux » de recevoir par e-mail de la publicité pour des sociétés de recouvrement, et ce, dans le but de récupérer nos honoraires !
Tout cela me parait profondément affligeant et devrait à mon sens justifier de réactions appropriées face à un système qui nous écartera à l’avenir de quantités d’opportunités et qui de toute façon poursuivra le déclin des petits et moyens cabinets et la grande difficulté dans laquelle se trouvent les jeunes confrères pour développer leur activité dans le secteur public.
La libre concurrence, sans limite, pouvant même s’entendre d’offres en dessous du coût réel, n’a pas d’autre conséquence que la catastrophe à terme.
Terminons en souriant : comment les huissiers peuvent –ils s’inscrire dans cette logique de concurrence alors que leurs frais et honoraires sont tarifés ?
Ajouter un commentaire